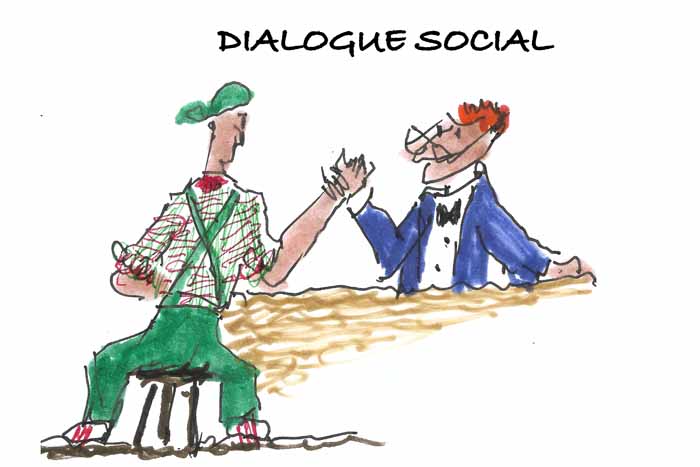Un dispositif nouveau et expérimental
Le dispositif est expérimental pour les fonctionnaires titulaires jusqu’à fin 2025 et définitif pour les contractuels. Les stagiaires en sont exclus ainsi que les agents âgés de plus de 62 ans ou les détachés. Ce dispositif venu du privé et de la négociation interprofessionnelle a été mis en place le 1er janvier 2020. Il permet de mettre un terme à l’amiable à l’emploi d’un agent et donne droit aux allocations chômage. La rupture conventionnelle peut être conclue à l’initiative de l’agent ou à l’initiative de l’administration. Dans tous les cas, elle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des 2 parties.
Lorsque les 2 parties parviennent à un accord sur les conditions de la rupture conventionnelle, elles signent une convention de rupture selon un modèle de convention fixé par arrêté ministériel. Toute convention doit obligatoirement contenir le montant de l’indemnité de rupture (calculé sur l’ancienneté avec un plafond) et la date de cessation définitive des fonctions fixée par les parties d’un commun accord. Un délai de rétractation est prévu.
C’est donc un dispositif récent et qui plus est mis en place pendant la pandémie. L’analyse des chiffres est particulièrement pertinente au regard des inquiétudes sur l’attractivité des métiers de la fonction publique.
Qui est concerné ?
Sans surprise le ministère de l’Éducation nationale fournit les plus forts contingents. 59% des indemnités versées dans ce cadre dans la fonction publique d’État l’ont été par ce ministère en 2020 et 61,5% en 2021. Mais toutes les demandes ne sont pas acceptées, à cause notamment d’un coût financier trop lourd pour les administrations avec l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Ainsi, toujours dans l’EN, selon le ministère et le SGEN-CFDT, seules 296 des 1 219 demandes de ruptures conventionnelles déposées entre janvier et novembre 2020 ont abouti à une signature, soit environ 24% des démarches lancées. La part de refus est plus élevée que la part d’acceptation. Dans la fonction publique, la rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour l’agent qui souhaite en bénéficier.
En conclusion, à l’occasion des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, un certain nombre de pistes d’amélioration ont été présentées par la ministre. En premier lieu lever les obstacles à l’organisation du premier entretien obligatoire, il est vrai, il a été peu facile à mettre en place lors des périodes de confinement et de crise sanitaire. La ministre a rappelé qu’il n’est pas nécessairement conclusif et que les administrations peuvent organiser des entretiens supplémentaires qui ne sont pas encadrés par des délais réglementaires.
De nombreux observateurs rajoutent que le ministère devrait lancer une réflexion sur l’impact financier des indemnités versées. Ce n’est pas négligeable et cela aurait dissuadé les ministères d’accorder des ruptures conventionnelles. Les chiffres en témoignent ! Enfin, il sera utile dans le futur de connaitre le profil des emplois occupés pour mieux analyser l’attractivité des postes et des métiers.

Sources
- Acteurs publics - 19 janvier 2022
- Textes règlementaires :
- Article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
- Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle
et le - Décret n° 2019-1596 du même jour relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
- Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.